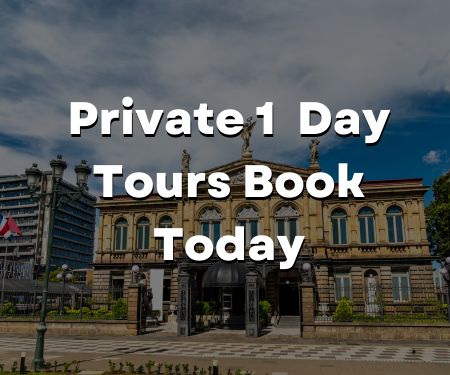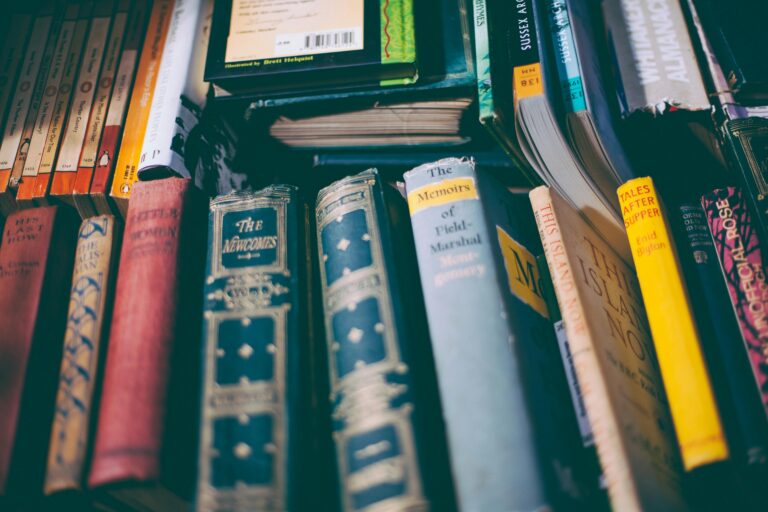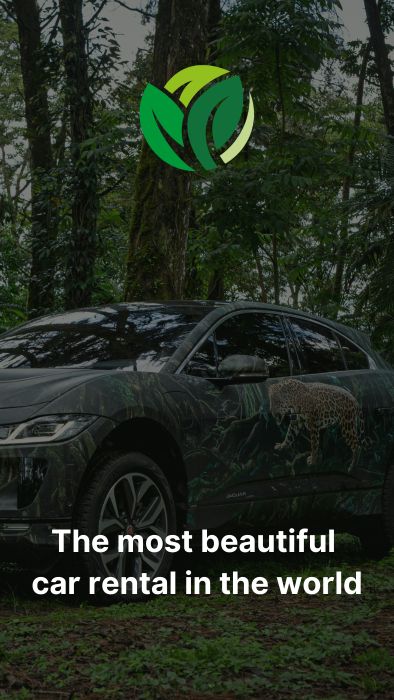Lorsque le docteur Mauricio Hoyos, biologiste marin mexicain renommé pour ses recherches sur les requins, s’est embarqué pour l’île Cocos, il savait que son métier comportait des risques. Mais rien ne pouvait le préparer au moment où un requin de près de quatre mètres l’a attaqué et a emprisonné sa tête entre ses mâchoires.
L’incident s’est produit à la fin du mois de septembre 2025, lors d’une expédition scientifique visant à marquer et à suivre des requins dans les eaux protégées du parc national de l’île Cocos, à environ 550 kilomètres du continent. Alors qu’il plaçait un dispositif de suivi sur un requin des Galápagos, l’animal a soudainement changé de direction et l’a mordu avec une force que les sauveteurs ont qualifiée d’« énorme ».
« Ma tête entière était dans sa bouche », a raconté Hoyos quelques jours plus tard depuis l’hôpital México, à San José, où il a été transféré après une opération de sauvetage de plus de 36 heures par mer et par terre. Le requin, selon lui, l’a relâché presque immédiatement, probablement après avoir compris qu’il ne s’agissait pas d’une proie.
L’attaque lui a causé de graves blessures à la tête, au visage et aux bras, mais sa vie a été sauvée grâce à la réaction rapide de son équipe et à la coordination entre les gardes-parcs, la fondation For the Oceans et les médecins mobilisés pour son évacuation.
Le cas de Hoyos met en lumière les dangers auxquels sont confrontés les scientifiques qui travaillent en première ligne de la conservation marine. Depuis plus de vingt ans, il consacre sa carrière à l’étude du comportement des requins et à la déconstruction des mythes sur leur prétendue agressivité. « Ce n’était pas une attaque de prédation », explique-t-il. « C’était une réaction, un accident dans un milieu où ils sont les maîtres ».
L’expédition faisait partie d’un programme visant à comprendre les routes migratoires des requins entre l’île Cocos et d’autres réserves du Pacifique oriental, un corridor biologique essentiel pour de nombreuses espèces menacées. Ces recherches permettent d’identifier les zones de reproduction, les couloirs migratoires et les zones de pêche illégale, autant d’informations cruciales pour renforcer la protection marine.
L’accident relance également la réflexion sur les protocoles de sécurité lors des missions scientifiques. Les chercheurs réclament davantage de moyens pour développer des outils de marquage à distance et améliorer la formation sur le terrain. Bien que ces accidents soient extrêmement rares, celui-ci rappelle que, même avec expérience et prudence, la mer reste imprévisible.
En convalescence, Hoyos garde un ton serein et reconnaissant. Dans ses déclarations, il a insisté sur le fait qu’il ne blâme pas le requin. « L’océan est magnifique, mais il est sauvage », a-t-il déclaré. « Il faut le respecter ».
La communauté scientifique internationale salue son courage et son dévouement. Loin de renoncer à la mer, Hoyos affirme qu’il retournera plonger. « Mon travail est de les protéger », conclut-il. « Et je ne peux pas faire cela depuis la terre ferme ».